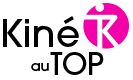Le modèle STAR–Shoulder : une approche clinique structurée pour rééduquer l’épaule
Par Frédéric Srour. Kinésithérapeute.
Les douleurs de l’épaule sont fréquentes et peuvent fortement impacter la qualité de vie des patients. Traditionnellement, les cliniciens s’appuient sur un modèle patho-anatomique, qui cherche à identifier la lésion (tendinopathie, capsulite, instabilité, etc.). Mais cette approche montre vite ses limites : à diagnostic égal, les présentations cliniques et les besoins en rééducation peuvent varier grandement.
C’est pour mieux prendre en compte la complexité des troubles de l’épaule que Philip McClure et Lori Michener ont proposé en 2014 le modèle STAR–Shoulder (Staged Approach for Rehabilitation). Ce modèle repose sur trois étapes cliniques complémentaires, qui permettent de structurer l’évaluation et d’individualiser la prise en charge de manière cohérente.

Étape 1 : Dépistage – Identifier les facteurs d’alerte et le contexte global
Avant d’entrer dans une logique de traitement, le clinicien ou la clinicienne commence par évaluer le contexte du patient afin d’assurer une prise en charge sécurisée et adaptée.
Repérer les drapeaux rouges et jaunes
Cette étape permet :
Étape 2 : Classification patho-anatomique – Comprendre les structures impliquées
Une fois le dépistage réalisé, le clinicien procède à une évaluation structurelle fondée sur :
Regrouper les présentations cliniques en catégories utiles pour la rééducation
Cette classification a pour objéctif d’orienter le traitement à partir des principaux tableaux cliniques connus que sont :

Cette étape permet de :
Mais à elle seule, elle ne suffit pas à guider les modalités de rééducation. C’est pourquoi l’étape suivante est essentielle.
Étape 3 : Classification pour la rééducation – Personnaliser l’intervention
Cette troisième étape est le cœur opérationnel du modèle STAR. Elle repose sur deux axes d’analyse complémentaires :
a. Le niveau d’irritabilité tissulaire
Il reflète le degré de douleur et de réactivité des tissus à la sollicitation, ce qui permet d’ajuster l’intensité des interventions :
Niveau
Signes cliniques
Implications thérapeutiques
Haute
Douleur > 7/10, présente au repos et la nuit, mobilité active < passive
Rééducation douce, éviter les gestes douloureux, réduire l’inflammation
Modérée
Douleur modérée (4–6/10), en fin d’amplitude, mobilité active ≈ passive
Mobilisations contrôlées, exercices progressifs
Faible
Douleur < 3/10, pas de gêne au repos, bonne tolérance au mouvement
Renforcement dynamique, travail intensif et fonctionnel
Cette hiérarchisation permet de moduler la charge, l’intensité et la progression des exercices en fonction de l’état du patient au moment de son évaluation.
b. Les déficiences spécifiques à corriger
En complément du niveau d’irritabilité, le clinicien identifie les déficiences motrices et fonctionnelles, parmi lesquelles :
Cette analyse permet de déterminer :
Ainsi, la rééducation devient adaptée à la fois au stade clinique et au profil du patient, et peut évoluer dans le temps.
Un modèle ancré dans la pratique moderne
Plus de 10 ans après sa description, le modèle STAR–Shoulder constitue une référence internationale dans la prise en charge des pathologies de l’épaule. Il est utilisé — parfois sans être nommé — par de nombreux cliniciens experts en rééducation.
Ses forces principales :

La note au TOP
Le modèle STAR–Shoulder propose une approche clinique en trois étapes structurées et intégrées, alliant sécurité, précision diagnostique et individualisation de la rééducation. En considérant le contexte du patient, la nature de l’atteinte et sa réponse au traitement, ce modèle permet une prise en charge ciblée, évolutive et centrée sur la personne soignée.
Il s’impose aujourd’hui, en tant que tel ou selon des variantes, comme un outil incontournable pour les professionnels de la rééducation de l’épaule, au service d’un traitement plus pertinent, plus humain et plus efficace.