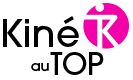Entorse latérale de la cheville : ce que recommande la HAS en 2025
Par Arnaud Van Marck, Jean-baptiste Duault & Frédéric Srour. Kinésithérapeutes.
Fréquente mais souvent banalisée, l’entorse du ligament collatéral latéral (LLE) de la cheville demeure un motif majeur de consultation en kinésithérapie. La variabilité de sa prise en charge reste importante, parfois éloignée des meilleures pratiques fondées sur les preuves.
En avril 2025, la Haute Autorité de Santé (HAS) a publié de nouvelles recommandations de bonne pratique intitulées « Entorse du ligament collatéral latéral (ligament latéral externe) de cheville : diagnostic, rééducation et reprise de l’activité physique et de la pratique sportive ». Ce texte actualise les recommandations de l’ANAES (2000, 2006) à la lumière des avancées cliniques et scientifiques, notamment en matière de critères diagnostiques, de prévention des récidives et de reprise d’activité.

Un diagnostic avant tout clinique

Le diagnostic d’entorse latérale de cheville repose avant tout sur l’interrogatoire et l’examen clinique, réalisés idéalement dans les 24 heures suivant le traumatisme (ou jusqu’à 48 heures). L’entorse typique résulte d’un mouvement d’inversion forcée, provoquant une douleur immédiate au niveau du faisceau antérieur du LLE, souvent accompagnée d’un œdème et parfois d’un hématome.
Les tests recommandés incluent :
L’imagerie n’est justifiée qu’en cas de suspicion de fracture (évaluée selon les critères d’Ottawa et éventuellement les critères Bernois), de doute diagnostique, ou d’évolution atypique après quelques jours. La HAS souligne que le diapason à 128 Hz peut être un outil complémentaire utile pour orienter la décision de radiographie lorsque son accès est limité.
Classification et vigilance clinique
Trois grades de gravité sont distingués (I à III), mais la classification doit rester prudente, car les signes objectifs (laxité, instabilité mécanique, déchirure complète) ne sont pleinement évaluables qu’à distance de la phase aiguë.
La HAS recommande d’identifier les facteurs de risque intrinsèques et extrinsèques d’entorse ou de récidive, en distinguant ceux qui sont modifiables (faiblesse musculaire, instabilité posturale, antécédents récidivants) de ceux qui ne le sont pas (morphologie, laxité constitutionnelle).
Certaines entorses apparemment « bénignes » peuvent évoluer vers une instabilité chronique en l’absence de rééducation adaptée. Un suivi précoce par un professionnel formé est donc fortement recommandé, même pour les entorses de grade I et II.
Une rééducation active, précoce et structurée
La rééducation est considérée comme la pièce maîtresse du traitement (grade A à B selon les composantes). Elle doit être entreprise dès la première semaine suivant le traumatisme.
Les objectifs sont :
Les techniques passives isolées (ultrasons, laser, TENS, cryothérapie en monothérapie, ondes de choc) ne sont pas recommandées.
L’immobilisation rigide n’est indiquée que pour les entorses sévères (grade III), pour une durée n’excédant pas dix jours, et toujours associée à une rééducation fonctionnelle.
Le port d’une attelle souple est recommandé pour les entorses de grade I (≤ 2 semaines), tandis qu’une attelle semi-rigide peut être proposée pour les grades II et III (2 à 6 semaines selon l’évolution).
Le strapping ou bandage élastique adhésif n’est pas recommandé en cas d’instabilité marquée.

Outils et mesures fonctionnelles
La HAS introduit plusieurs outils validés pour objectiver la récupération :
Reprise du sport : des critères objectifs plutôt qu’un calendrier arbitraire

La reprise de l’activité physique ou sportive ne doit pas être fondée sur un délai fixe (3 à 6 semaines), mais sur des critères fonctionnels objectivables.
La HAS recommande l’utilisation du score Ankle-GO pour guider la décision de reprise chez l’adulte.
Les critères principaux sont :
Chez les enfants et les personnes âgées, la HAS souligne l’absence de critères validés et encourage la recherche clinique dans ces populations.
Prévention et suivi
Les exercices proprioceptifs du pied et de la cheville (grade B) réduisent le risque de premier épisode d’entorse (prévention primaire).
En prévention secondaire, la rééducation basée sur l’exercice (grade A) diminue le risque de récidive et d’instabilité chronique.
Le port d’une attelle souple ou d’un bandage pendant l’activité physique est recommandé, notamment entre J5 et J21 après une entorse de grade II ou III.
Collaboration inter-professionnelle
La HAS recommande une coordination interprofessionnelle structurée entre médecins, kinésithérapeutes, urgentistes et autres professionnels de santé.
Les échanges peuvent être organisés selon le format SAED (Situation, Antécédents, Évaluation, Demande), pour une communication orale ou écrite efficace.
Conclusion
Les recommandations 2025 de la HAS réaffirment le rôle déterminant du kinésithérapeute dans la prise en charge des entorses latérales de cheville : diagnostic clinique rigoureux, rééducation active et raisonnée, suivi fonctionnel objectivé, et prévention des récidives.
L’approche proposée est fondée sur la gradation du niveau de preuve, la mesure des résultats fonctionnels, et la collaboration interdisciplinaire.

La note au TOP
Notre expérience nous montre qu’en matière de rééducation active le renforcement des extenseurs de cheville, genou en extension et genou en flexion, constitue un point primordial en rééducation, en parallèle du renforcement des inverseurs et des éverseurs en tant que stabilisateurs de la cheville.
S’agissant des outils et tests fonctionnels il est possible de proposer aux patients qui ne sont pas capables de réaliser des tests de sauts de réaliser le Star Excursion Balance Test ainsi que le Heel Rise Test au préalable.
Référence
Haute Autorité de Santé (HAS). Entorse du ligament collatéral latéral (ligament latéral externe) de cheville : diagnostic, rééducation et reprise de l’activité physique et de la pratique sportive. Avril 2025.
Disponible sur : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3460983/fr/entorse-du-ligament-collateral-lateral-ligament-lateral-externe-de-cheville-diagnostic-reeducation-et-reprise-de-l-activite-physique-et-de-la-pratique-sportive